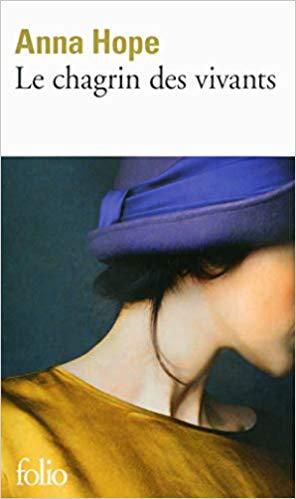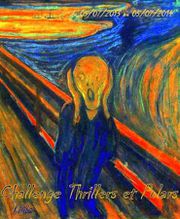Editions Flammarion - 2017 - 506 pages
Ali est devenu propriétaire d'oliviers qui lui ont permis de prospérer et de devenir de ceux qu'on dit qu'ils ont réussi. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, il garde une fierté de s'être battu pour la France, et surtout qu'on lui reconnaisse ce sacrifice. Lorsqu'apparaissent les premiers signaux de désirs d'indépendance de l'Algérie, il ne souhaite pas prendre position, et se retrouve presque malgré lui du côté des Français. A la fin du conflit algérien, il se voit obligé de quitter sa terre natale pour rejoindre la France et redémarrer sa vie, avec sa femme et ses enfants.
Dans la carrière d'un auteur, il faut souvent quelques productions avant que le lecteur ne se dise : "Ca y est, on y est!". Le voici le roman d'Alice Zeniter, celui de la maitrise, de l'aboutissement. Il se divise en trois parties: la première parle d'Ali, le grand-père kabyle, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, qui voit arriver les "événements d'Algérie (ou comment ne pas parler de guerre) sans qu'il ait eu le temps de savoir qui il souhaitait soutenir. Car il faut choisir un camp: soit les Français, les oppresseurs, soit le FLN, la voie de l'avenir mais avec une organisation et des objectifs on ne peut plus flous et parfois contestables. L'auteure montre avec beaucoup de finesse toute la complexité de cette période, le fait que tout le monde n'était pas préparé à avoir des avis aussi tranchés qui auraient justifié une prise de position nette. Ainsi, plus par réaction que par réelle conviction, Ali se retrouve à aider les Français. Il devient un harki, stigmate qui marquera toute sa famille à vie. J'ai trouvé cette partie vraiment intéressante, très bien décrite.
La seconde partie se focalise sur Hamid, l'aîné de la famille, à partir du moment où la famille se voit contrainte de quitter l'Algérie, après la signature des accords d'Evian, pour rejoindre la France, ce pays totalement inconnu, en terme de territoire. C'est quitter son pays, ses proches, ses terres, toute une vie, pour tout recommencer, dans des camps pour les harkis. Pour Hamid, c'est voir ses parents, qui ne savent ni lire ni écrire, courber l'échine, accepter l'humiliation. C'est aussi être un pilier pour la famille, les amis, les voisins, celui auquel on se raccroche car il possède l'instruction. Et puis, au fur et à mesure qu'Hamid, le fossé générationnel avec sa famille et son père en particulier, se creuse, jusqu'à laisser la place à l'incompréhension et l'éloignement, le rejet de ces origines qui lui laissent un goût amer à plus d'un titre.
Enfin, la dernière partie traite du retour aux sources, de la mémoire, par Naïma, une des filles d'Hamid, qui tente de reconstituer une histoire qui est la sienne, alors que son père a toujours été mutique sur le sujet. Car sa famille est une famille harkie, les traitres, avec toute la honte et la crainte que cela suppose.
"La vie de mon grand-père (...) on distinguerait deux silences, qui correspondent aux deux guerres qu'il a traversées. La première, celle de 39-45, il en est ressorti en héros et alors son silence n'a fait que souligner sa bravoure et l'ampleur de ce qu'il avait eu à supporter. On pouvait parler de son silence avec respect, comme d'une pudeur de guerrier. Mais la seconde, celle d'Algérie, il en est ressorti traître et du coup son silence n'a fait que souligner sa bassesse et on a eu l'impression que la honte l'avait privé de mots. " p. 493-494
"Ce qu'on ne transmet pas, ça se perd, c'est tout. Tu viens d'ici mais ce n'est pas chez toi." p. 497
Je considère ce roman comme une référence sur le sujet, c'est fouillé, nuancé, maitrisé, bien écrit, et surtout empreint d'un engagement de l'auteure dans ce qu'elle a mis d'elle, de sa propre histoire dans ce récit. Elle retranscrit avec un grand talent toute la complexité de la colonisation, la question du rapport avec ses origines, de la transmission, du sentiment d'appartenance. Un grand livre, qui a reçu le Prix Goncourt des Lycéens.
Ma note:

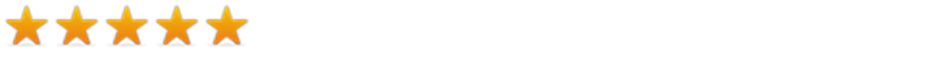


/image%2F1225039%2F20231205%2Fob_6510b7_babysitter.jpg)